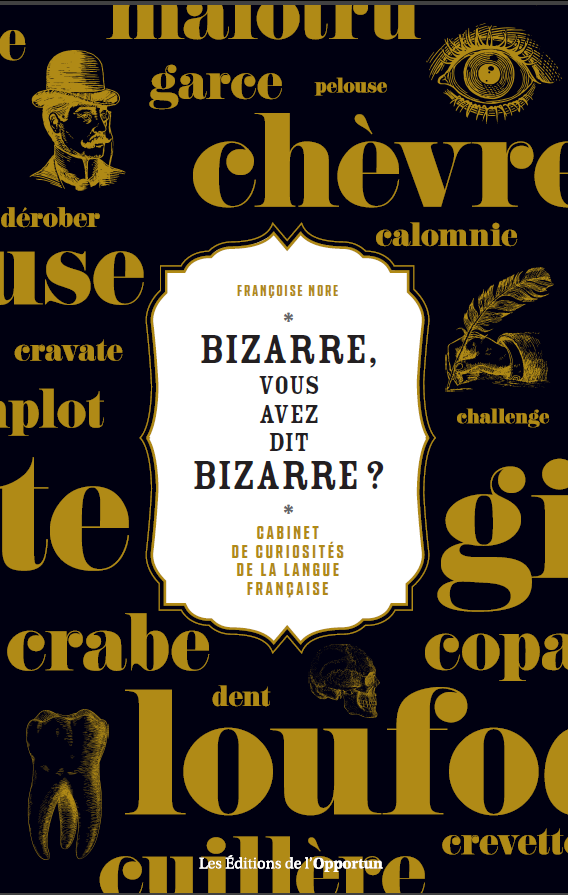Curiosités lexicales
Rapprochements étymologiques erronés
Généralement, deux mots proches dans leur forme et appartenant au même champ notionnel ont un étymon commun ; ainsi, chanson et chant proviennent tous deux, en dernière ligne, du verbe latin canere « chanter ». Mais il existe des couples de mots qui, en dépit de leur ressemblance formelle et de leur proximité sémantique, ont en réalité des origines toutes différentes. Examinons donc ce que l’on peut désigner par l’appellation de fausses familles étymologiques.
Échec et échouer
Le nom échec remonte au nom persan shah « roi », qui parvint en Europe par l’intermédiaire de l’arabe, emprunteur du nom persan. Shah prit en ancien français diverses formes ; vers 1100, on rencontre la forme au pluriel eschecs, qui désigne le jeu bien connu. Vers 1165, la forme eschac est une interjection lancée par l’un des deux joueurs afin d’avertir son adversaire que son roi était menacé. À la même époque est attestée la graphie eschec ; ce nom a alors les significations de « jeu », « pièce du jeu d’échec » et « situation du roi ou de la reine menacés d’être pris ». En 1174, la forme eschés nomme les pièces du jeu. Enfin, vers 1223, le nom eschec prend le sens figuré d’« embarras, obstacle, insuccès ». Le c final d’échec est peut-être dû à un croisement de ce mot avec le nom d'ancien français eschec « butin », présent vers 1100 dans La Chanson de Roland, issu de l'ancien bas francique *skāk, de même sens.
Au vu du sens d’échec « insuccès », il était logique de le lier étymologiquement au verbe échouer, bien que ce dernier soit plus récent. En effet, échouer est attesté en 1559 sous la forme de participe passé adjectivé dans le syntagme galeres eschouees, au féminin pluriel. En 1573, échouer est enregistré dans un dictionnaire français-latin avec le sens de « toucher le fond et ne plus naviguer ». La signification figurée de « ne pas réussir une action entreprise » est enregistrée, pour sa part, en 1660. Or, bien qu’il soit entré tardivement dans le lexique français, échouer reste d’origine inconnue. Certains chercheurs proposèrent une filiation à partir du latin populaire *excautare, issu de cautes « rocher », ou encore une variante du verbe de bas latin exsucare « assécher », qui a donné essuyer mais, vu la date tardive d’apparition d’échouer, un étymon latin est extrêmement peu probable. La seule possibilité serait un changement à partir du verbe échoir « être dévolu, revenir à quelqu’un », attesté vers 1135, d’après l’ancienne prononciation /ešwęr/ ; mais cette explication suppose une nouvelle conjugaison avec une répartition des formes et des sens, difficile à admettre, pour les deux verbes. Ainsi, l’étymologie d’échouer reste en débat.
De ce qui précède, il apparaît clairement qu’échec et échouer n'ont pas d’étymon commun. Échec nous vient du persan shâh « roi ». Échouer, qui ne possédait au départ que le sens maritime de « faire échouage », est d'étymologie inconnue. Ces deux mots ne sont donc pas issus d’une racine commune.
Faute et fauteur
Le nom faute est très ancien en français puisqu’il est enregistré en 1174 avec le sens de « manquement, action de faillir à quelque chose ». En 1275, faute signifie « manque, privation ». Ce nom vient d’un nom de latin populaire, *fallita « manque, action de faillir », que l’on fait remonter au mot falsus, participe passé du verbe latin fallere « tromper ». En ce qui concerne le nom fauteur, présent en 1295 avec le sens de « qui favorise, qui excite », il s’agit d’un emprunt au nom de latin classique fautor « personne qui favorise quelqu’un ou quelque chose, défenseur, partisan ». Le nom fautor dérive lui-même du verbe latin favere « favoriser ». Aujourd’hui, fauteur est essentiellement utilisé dans l’expression fauteur de troubles. Au demeurant, et contrairement à ce que l’intuition laisserait supposer, faute et fauteur ne sont pas apparentés par l’étymologie.
Habiller et habit
Le verbe habiller est attesté, vers 1200, sous la forme pronominale conjuguée s’abille ; il avait alors pour sens « se préparer, s’apprêter ». S’abiller « se vêtir » est enregistré au début du XVe siècle. Sous sa forme simple, abiller eut plusieurs significations, dont celle de « préparer, équiper ». Habiller dérive du nom bille « tronc d’arbre » ; qui vient peut-être du nom gaulois *bilia, de même sens. Abiller signifiait donc « préparer une bille de bois », d’où, par glissement métaphorique, « équiper ». La graphie avec un h initial apparut durant le XVe siècle ; on la relève notamment dans le syntagme mal habillee, attesté en 1548.
La présence du h à l’initiale d’habiller s’explique probablement par un rapprochement avec le nom habit ; or, ce dernier est d’une autre origine. Le verbe latin habere « avoir » avait donné le nom habitus « mise, tenue vestimentaire ». En ancien français, habitus prit la forme abit, enregistrée en 1155 avec le sens de « vêtement de religieux ». Durant le premier quart du XIIIe siècle, c’est-à-dire entre 1200 et 1225, on rencontre la forme habit, signifiant « habillement », graphiée avec un h initial, qu’il est difficile d’expliquer. Au demeurant, habiller et habit ne partagent pas d’étymon commun, comme cela vient d’être montré et contrairement à ce que l’on pourrait spontanément penser.
Miniature et minimum
Le nom miniature entra en français en 1645 sous la graphie mignature et avec la signification de « portrait de très petites dimensions » ; ce nom est présent dans La Suite du Menteur de Corneille. Peu après, en 1653, la forme miniature est attestée, mais mignature perdurera encore quelque peu. Miniature est un emprunt à l’italien miniatura « figure de très petites dimensions, peinte de couleurs vives, servant à orner les livres, les parchemins, de petits objets d'ivoire, etc. » et « art de peindre cette sorte de figures ». Miniatura, enregistré avant 1342, dérive du verbe italien miniare « décorer avec des figures de petites dimensions », lui-même emprunté au verbe latin miniare « peindre en rouge, enduire de minium », qui provient du nom minium « vermillon » ; le nom minium « peinture antirouille » est d’ailleurs usuel en français. Les figures peintes de petites dimensions étaient donc de couleur rouge, ce qui explique leur nom en italien. On constate ainsi que miniature est sans rapport étymologique ni avec minimum, entré en français en 1705, dérivé de l’adjectif latin minimus « le plus petit », ni avec mini, abréviation de minimum. Le rapport perçu entre miniature et minimum vient du fait qu’une miniature est toujours un objet ou un ornement de petites dimensions.
Ouvrable et ouvrir
Le verbe ouvrir est enregistré en français, à la fin du Xe siècle, sous la forme obrir ; il a le sens contemporain de « déverrouiller ». Vers 1100, la graphie uvrir est attestée, et la forme d’imparfait ouvroit est présente dans un texte daté de la première moitié du XIIIe siècle. Ouvrir provient du verbe de latin populaire *operire « ouvrir », lui-même altération du verbe de latin classique aperire, de même signification. Contrairement à ce que laisse penser l’intuition, ouvrir n’est pas à l’origine de l’adjectif ouvrable, qui qualifie un jour travaillé. Enregistré vers 1170 dans la tournure jur uverable « jour où l’on peut travailler », qui sera graphiée jour ouvrable en 1260, ouvrable dérive du verbe ouvrer, attesté dès la fin du Xe siècle avec la signification d’« agir, opérer » et en 1175 avec celle de « travailler ». Ouvrer provient du latin classique operari « travailler, s’occuper », lui-même dérivé du nom opera « travail, activité ». Ce verbe, qui ne s’emploie plus guère, a été remplacé depuis le XVIIe siècle par travailler, notamment en raison de l’homophonie entre certaines formes conjuguées d’ouvrer et d’ouvrir.
Plante et plantureux
Le nom plante est enregistré en 1273 avec le sens de « plantation » puis, bien plus tard, en 1532, avec celui d’« exemplaire du règne végétal ». Le verbe planter, pour sa part, est attesté vers 1130 avec la signification de « fixer un végétal dans la terre ». Ce nom et ce verbe dérivent, après plusieurs formes intermédiaires, du verbe latin plantare « enfoncer de la terre ». L’adjectif plantureux « bien en chair » et « copieux » apparaît en français sous la forme plantëurose vers 1165 ; il a alors le sens de « fertile, riche, abondant ». À la fin du XIIe siècle, cet adjectif, avec la même signification, est enregistré sous la forme plentiveuse. Peu de temps après, vers 1210, l’expression planteurouse de « largement pourvu de » est présente dans la littérature. Cet adjectif est une altération de l’adjectif d’ancien français plentiveux, lui-même dérivé d’un autre adjectif disparu, plenteif « fertile, abondant », provenant du nom plentet « abondance, grande quantité ». Ce dernier nom est la francisation d’un nom latin enregistré durant le premier siècle de notre ère, plenitas « abondance, plénitude ». Il n’existe donc aucune relation étymologique entre les mots de la famille de planter et l’adjectif plantureux. Ce rapport supposé est probablement dû à l’expression familière une belle plante, qui désigne généralement une femme aux formes séduisantes.
Rasta et rastaquouère
Le mot rasta est l’abréviation de rastafari, qui désigne une secte jamaïcaine dont les membres croyaient que l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié (1892-1975) était Dieu et qu’il les ferait retourner en Afrique. Ras Tafari était le nom porté par Haïlé Sélassié de 1916 à 1930, date de son accession au trône d’Éthiopie. Rasta en tant que nom est enregistré en français en 1976, en tant qu’adjectif en 1979, et l’adjectif rastafari en 1979. En anglais, l’adjectif rasta et le nom rastafarian sont enregistrés en 1955.
Or, rasta rappelle évidemment le nom rastaquouère qui, même s’il n’est plus courant aujourd’hui, fut relativement utilisé, notamment dans la littérature. Rastaquouère est attesté en 1881 et son abréviation rasta, en 1886, dans des essais du romancier Joris-Karl Huysmans (1848-1907). Ce nom est un emprunt à l’hispano-américain (ar)rastracueros « personne méprisable », « tanneur de peaux, de cuirs », composé d’une forme issu du verbe arrastrar « ratisser » et du nom cueros « cuirs, peaux ». En français, rastaquouère était utilisé avec le sens d’« individu aux revenus supects, affichant un luxe voyant et de mauvais goût ». Cette signification péjorative est probablement due au fait que beaucoup de Sud-Américains à l'élégance tapageuse, qui séjournaient à Paris à la fin du XIXe siècle, devaient leur fortune récente au commerce des cuirs et peaux. Notons que ce mot fut réemprunté au français, avec ce nouveau sens, par l’hispano-américain d'Argentine et du Chili.
De ce qui précède, il est aisé de comprendre que le nom rasta, utilisé aujourd’hui notamment en référence au monde du reggae, et le nom rastaquouère ne partagent pas d’étymon commun.
Saynète et scène
Le nom saynète entra en français en 1764 sous la graphie saïnete ; il était alors de genre masculin et avait la signification de « petite pièce comique espagnole ». Toutefois, il s’agit d’une attestation isolée. Avec la forme saynete, ce nom entra dans l’édition de 1823 du dictionnaire du lexicographe Pierre Boiste (1765-1824), sans changer de sens. La nouvelle graphie saynète est présente en 1855 dans l’ouvrage intitulé Histoire de ma vie, autobiographie de George Sand (1804-1876) ; par extension, saynète désigne alors une petite pièce comique très courte, sans référence particulière à la culture espagnole. Ce nom est un emprunt du nom espagnol sainete, attesté depuis 1385 avec les sens successifs de « petit morceau de nourriture donné en récompense à un faucon de chasse », « toute bouchée agréable au goût », « toute chose plaisante » et enfin « pièce bouffonne en un acte qu'on donnait avant le deuxième acte d'une comédie » ; cette dernière signification est enregistrée au début du XVIIe siècle. Notons que sainete est un diminutif du nom saín « graisse, spécialement des animaux ». Initialement, sainete désignait donc le morceau de lard que le fauconnier plaçait sur son gant pour rappeler son rapace en vol. Puis ce nom désigna l'assaisonnement salé d'un plat : on insérait une tranche de lard entre deux tranches de viande pour en relever la saveur. C’est donc par métaphore que sainete passa du lexique de la cuisine à celui du théâtre : pour faire patienter les spectateurs, des intermèdes plus ou moins grossiers sont donnés en représentation, entre les deux parties d’un spectacle, comme une tranche de lard est glissée entre deux tranches de viande.
Dans la mesure où une saynète est une pièce comique de courte durée, il fut aisé de la considérer comme une petite scène, même si les noms scène et saynète ne présentent pas une graphie particulièrement similaire. Scène, présent dans un texte daté de 1531, est un emprunt au latin scaena « scène d’un théâtre, théâtre », « comédie, intrigue » et « partie d’un acte », lui-même emprunté au grec skene. Ces deux noms, en dépit d’une proximité sémantique évidente, n’ont donc pas d’étymologie commune.
Les mots étonnants de l'internet
Certains mots relevant du lexique de l’internet et des technologies contemporaines présentent quelques faits étonnants eu égard à leur étymologie, comme cela va être montré dans les paragraphes suivants.
Bluetooth
Le nom Bluetooth, dont le sens littéral est « dent bleue », a pour origine le roi danois Harald Ier (vers 910-985), né Harald Gormsson, dont le surnom était Harald Blåtand, c’est-à-dire Harald à la Dent bleue. Comme ce monarque unifia une partie de la Scandinavie, on peut conjecturer que le choix de son surnom pour désigner une technologie unissant divers appareils entre eux s’imposa aux constructeurs de téléphonie mobile qui conçurent ce système.
Geek
Le nom geek vient du nom dialectal anglais geek ou geck « fou », « monstre », « simplet », attesté dans les années 1510, lui-même issu du moyen bas-allemand Geck, de même sens. En Amérique du Nord, au XIXe siècle, geek désignait un artiste participant à un spectacle de cirque, de carnaval ou de fête foraine. En 1911, geek est enregistré dans l’argot anglo-américain, toujours dans les domaines du carnaval et du cirque, avec le sens plus précis de « phénomène de foire ». En 1949, geek entre dans le lexique général ; il est alors utilisé pour désigner une personne détestée et, dans les années 1970, il prend le sens proche de « personne sans valeur ». Geek entra ensuite dans l’argot ; en 1980, les adolescents américains l’emploient étonnamment avec deux significations éloignées, celle de « personne bizarre » et celle de « personne studieuse ». Tout au long des années 1980, le terme a toujours été employé de manière insultante, même par les fanatiques de la technologie. À partir de 1989, geek prit dans l’argot des universités un sens neutre, sans connotations péjoratives, celui de « personne ayant une connaissance ou une capacité particulière ». Dans les années 1990, il est souvent associé à un autre mot, comme dans les locutions geek movie et computer geek. Et en effet : aujourd’hui, geek nomme une personne, généralement de sexe masculin, fortement adepte de l'informatique, de la science-fiction, des jeux vidéo et des technologies contemporaines au sens large. Ce nom ne se traduit pas, car il s’agit d’un xénisme. Certes, il pourrait être rendu par fana ou par spécialiste des technologies contemporaines, mais cela reste imprécis puisque le contenu sémantique de geek est plus large.
Le nom Google désigne le moteur de recherche bien connu, fondé en 1998 ; à l’origine, cette appellation nommait un projet de recherche mené par deux doctorants de l'université de Stanford (Californie). Google tire son nom du terme mathématique anglais googol, qui représente le nombre 10100, c'est-à-dire un nombre commençant par 1 et suivi de cent zéros ; le choix de googol s’explique par le fait que le moteur de recherche était destiné à fournir de très grandes quantités d’informations. Cela étant, la forme google est une erreur de graphie de googol, mais elle fut retenue par les concepteurs californiens.
Même
Un mème internet est un élément, généralement graphique, repris et diffusé massivement sur la toile ; ce peut être une photo, une vidéo, une phrase ou un gif. Le nom mème est la francisation et l’abréviation de la locution anglaise Internet meme. Le nom meme apparaît en anglais en 1976 ; il est dû au biologiste britannique Richard Dawkins qui le créa à partir de racines grecques et qu’il explique de cette façon dans son ouvrage intitulé The Selfish Gene : « We need a name for the new replicator, a noun that conveys the idea of a unit of cultural transmission, or a unit of imitation. 'Mimeme' comes from a suitable Greek root, but I want a monosyllable that sounds a bit like 'gene'. I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate mimeme to meme. If it is any consolation, it could alternatively be thought of as being related to 'memory', or to the French word même. It should be pronounced to rhyme with 'cream'. [Nous avons besoin d'un nom pour le nouveau réplicateur, un nom qui transmet l'idée d'un élément de transmission culturelle ou d’un élément d’imitation. Mimeme vient d'une racine grecque convenable, mais je veux un monosyllabe qui ressemble un peu à gene. J'espère que mes amis classicistes me pardonneront si j'abrège mimeme en meme. Si cela peut vous consoler, on pourrait également penser que ce nom est lié à memory [« mémoire, souvenir »] ou au mot français même. Il doit être prononcé comme cream.]. Le sens d’« image, vidéo ou texte largement et rapidement diffusé par les internautes » est enregistré en anglo-américain en 1997.
Mozilla
Mozilla était à l'origine le nom de code du navigateur Web Netscape Navigator et de la première mascotte de Netscape. Ce nom fut formé à partir de la locution Mosaic Killer « tueur de mosaïques », car Netscape voulait régner en maître dans son domaine, ce qu'il fit pendant un certain temps.
Spam
L’histoire du nom anglais spam « message électronique indésirable » est des plus intéressantes. À l’origine se trouve la marque américaine Spam, déposée en 1937, qui commercialise de la viande de porc précuite en boîte. Le nom spam est un acronyme puisqu’il provient de Spiced Ham « jambon épicé » ou de Spiced Pork and Meat « porc et viande épicés », selon les sources. Cette viande fut largement utilisée par les forces armées américaines pour la nourriture des soldats durant la Seconde Guerre mondiale. L’utilisation de spam pour dénommer un message indésirable, attestée depuis 1993, provient d’un sketch des Monty Python de 1970, intitulé Spam, qui se déroule dans un restaurant ; dans ce sketch, le mot spam, qui désigne le jambon en boîte, envahit la conversation, et tous les plats servis aux clients contiennent de cette préparation. Ce sketch parodie une publicité d’alors pour ce produit, publicité dans laquelle le nom de la marque était répété de multiples fois. Selon une théorie de la BBC fournie en 1999, l’emploi de spam avec le sens de « message indésirable » s’explique par le fait que la diffusion du sketch fut concomitante des débuts de l’internet. Et en effet : parmi les premiers utilisateurs de l’internet, certains d’entre eux, fans des Monty Python, avaient créé un forum consacré à ces derniers. Dans ce forum apparut un message contenant uniquement le mot spam répété des centaines de fois. Ce message se diffusa dans d’autres forums, et c’est ainsi que le fait de poster des messages sans référence au thème d'un forum finit par être appelé spamming. Le premier spam à visée professionnelle fut envoyé en 1978 par un employé d’une société américaine d’informatique à près de la totalité des utilisateurs d’Arpanet, l’ancêtre de l’internet, c’est-à-dire à quatre cents personnes. Pour remplacer ce nom anglais entré dans le Robert en 1997, nos amis québécois ont proposé pourriel, mot-valise formé de poubelle et de courriel, sinon de pourri et de mél, ce dernier remplaçant e-mail. Toutefois, pourriel ne s’impose pas en France. France Terme propose arrosage, qui peut nommer l’opération elle-même mais non un message individuel. On pourrait utiliser message indésirable, mais sa longueur ne plaide pas en sa faveur.
Yahoo
Le nom yahoo signifie « butor, rustre » dans l’argot américain ; dans le langage des enfants, il a pour sens « youpi ». Or, yahoo est un nom plutôt ancien : dans le roman Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift (1667-1745), publié en 1726, on rencontre des créatures sauvages et immondes, baptisées les Yahoos par le romancier. C’est en référence à ces êtres répugnants que les créateurs de Yahoo choisirent ce nom. Notons que, à l’origine, Yahoo était un annuaire web.
Des mots sans rime
L'article présent propose une liste de mots qui ne riment avec aucun autre mot. Évidemment, ni les noms propres ni les dérivés par préfixation n'entrent en ligne de compte : antibelge ne peut rimer avec belge.[1]
Il convient par ailleurs de délimiter ce que l'on prend en considération : soit l'ensemble de la syllabe, soit la totalité de sa partie vocalique, ou bien encore seulement la fin de cette même partie vocalique. Dans ce dernier cas, on pourrait accepter les mots ministre et sinistre comme rimes de cuistre. Mais nous avons fait le choix de prendre en compte les parties vocaliques dans leur ensemble, et donc de refuser le couple cuistre - ministre.
D'un point de vue de la forme, nous avons choisi de ne pas inclure de formes verbales qui pourraient rimer avec des mots de cette liste ; seuls les infinitifs sont pris en compte.
abrupt
belge
bulbe
chanvre
cuistre
dioptre[2]
drachme
fichtre
film
fourche
genre
girofle
goinfre
huître
humble
hydne (m.)[3]
incurve (adj.)
jungle
larve
ménechme (m.)[4]
meurtre
monstre
muscle
pampre[5]
pauvre
perdre
peuple
poivre
pourpre
propre
puisque
quatorze
quinze
sceptre
sépulcre
siècle
simple
stagner
stupre
sylve[6]
tertre
vaincre
zancle[7]
Il existe également quelques mots qui riment avec un seul autre mot. On notera que les mots avec lesquels ils riment sont, pour la plupart, des noms rares[8] :
Arbre (m.) et marbre (m.).
Camphre « substance extraite du camphrier » (m.) et fanfre (m.) « petit poisson, dit pilote du requin ».
Comble (m. et adj.) et omble (m.) « poisson d'eau douce ».
Sourdre (v.) « jaillir » et tourdre (m.) « variété de grive » et « poisson de la Méditerranée ».
Triomphe (m.) et gomphe (m.) « libellule de taille moyenne »
Valse (f.) et salse (f.) « volcan qui lance de la boue et une eau très salée ».
Vulve (f.) et ulve (f.) « sorte d'algue ».
[1] Les rimes incomplètes ne sont pas non plus prises en compte ; ainsi, ministre ne peut rimer avec cuistre, présent dans cette liste.
[2] Dioptre est un nom sans rime, rare, masculin ou féminin. Au masculin, il signifiait « dilatateur, spéculum ». Ce sens a disparu, et un dioptre désigne aujourd’hui, selon le TLFI, la surface séparant deux milieux transparents, homogènes et de réfringence différente. Au féminin, il s’agit d’un instrument employé en astronomie et en géométrie pour observer des objets éloignés.
[3] Espèce de champignon à chapeau hérissé.
[4] Synonyme très littéraire et plutôt rare de sosie.
[5] Le pampre est le rameau de vigne qui porte les feuilles et généralement les fruits.
[6] Dans un texte littéraire, sylve désigne un bois ou une forêt, tandis qu’il signifie « forêt équatoriale » en langage standard.
[7] Un zancle est un poisson osseux et brillant, aussi rare que son nom.
[8] Nous n’avons pas donné le sens des mots qui nous semblent compréhensibles de tous.
Quelques gentilés amusants
Si tous les gentilés s'étaient formés sans modifier le nom de leur commune et affichaient ainsi une forme prédictible, tels Parisien, Toulonnais et Seynois, que l'on peut identifier sans trop de risque de se tromper comme les noms désignant les habitants de Paris, de Toulon et de La Seyne, la vie serait simple. Elle serait même, peut-être, ennuyeuse. Aussi l'étymologie, des contraintes dérivationnelles mais aussi la fantaisie ont-elles créé quelques gentilés tout à fait inattendus, voire amusants. Nous présentons ici un florilège de quelques-uns de ces noms d'habitants aux sonorités ou aux homonymies des plus divertissantes.
|
Aiguilles (05) |
Aiguillon |
|
Béziers (34) |
Biterrois |
|
Bonny-sur-Loire (45) |
Bonnychon |
|
Bourré (41) |
Bourrinchon |
|
Cast (29) |
Castois |
|
Dolo (22) |
Dulcinéen |
|
Forges (61) |
Forgeron |
|
Fourches (14) |
Fourchu |
|
Grâces (22) |
Gracieux |
|
Joué-l'Abbé (72) |
Joyeux |
|
La Chapelle-Thémer (85) |
Théméraire |
|
La Mouche (50) |
Moucheron |
|
Le Vieux-Bourg (22) |
Vieux-Bourgeois[1] |
|
L'Hôtellerie (14) |
Hôtellier |
|
Longcochon (39) |
Couchetard |
|
Luc-sur-Mer (14) |
Lutin |
|
Lure (70) |
Luron |
|
Puteaux (92) |
Putéolien |
|
Saint-Mars-du-Désert (44) |
Marsien |
|
Saint-Pierre-la-Cour (53) |
Pierrotcourtois |
|
Villechien (50) |
Toutouvillais |
[1] La femme du Vieux-Bourgeois est la Vieux-Bourgeoise, et non pas la Vieille-Bourgeoise, ce qui ne serait pas très sympathique.
Quand les mots changent de sens
On n'en est pas forcément conscient, mais les mots que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas toujours eu le sens qui nous est familier, tant s'en faut.
Voici donc une liste non exhaustive de quelques mots dont la toute première signification, indiquée entre guillemets, ne laissera pas que d'étonner le lecteur :
abasourdir "tuer"
artifice "art, métier"
atout "malheur, revers"
baigneur "employé d'un établissement de bains"
baladeur "colporteur"
brasseur "ouvrier travaillant de ses bras"
brocanteur "colporteur"
camelot "tisserand d'étoffes en poil de chèvre"
carreleur "savetier ambulant"
cendrier "marchand de cendres"
chausseur "paveur de chaussées"
compassé "arrangé comme il convient"
coquetier "marchand de beurre, œufs et fromages"
coucheuse "dentellière"
éjaculer "lancer"
embonpoint "bonne santé"
énerver "ôter la force physique ou morale, rendre sans forces"
falot "gai, plaisant"
formidable "redoutable"
fruste "qui porte la marque d'une haute antiquité"
furieux "enthousiaste, exalté"
hilarité "joie douce et calme"
humoriste "d'humeur maussade"
laitier "fabricant de lattes en bois"
malice "méchanceté"
matrone "sage-femme"
médiocrité "modération, juste milieu"
mièvre "qui a de la vivacité, malicieux"
murmure "brouhaha, tumulte"
narquois "soldat démobilisé" puis "rusé, fourbe"
physicien "médecin"
poulailler "marchand de volailles"
préservatif "antidote", "remède"
promoteur "ecclésiastique relevant du ministère public dans une juridiction religieuse"
rêverie "délire causé par la fièvre"
riverain "batelier"
sommelier "gardien de bêtes de somme"
trafiquant "colporteur"
truculent "farouche, rude"
voiturier "transporteur"
Bien d'autres découvertes, tout autant étonnantes, sont à découvrir dans l'ouvrage suivant (plus d'informations en cliquant sur la photo) :